Caledonian Road, le nouveau roman d’Andrew O’Hagan, raconte la chute d’une élite intellectuelle contemporaine à travers la déchéance de Campbell Flynn, professeur d’université et figure médiatique, héros antipathique et ridiculement pathétique. C’est une fresque sociale et une satire féroce qui interroge et tourne en ridicule les dérives de nos sociétés.

Voilà que ça recommence… En 2024, Les Éphémères, le précédent roman d’Andrew O’Hagan (déjà chroniqué sur Benzine), devait être le livre de l’année. En 2025, un an après, les mêmes – ou presque – nous prédisent aussi que Caledonian Road sera aussi le livre de l’année ! Le résultat sera-t-il le même ? Les paris sont ouverts. Mais le résultat n’est pas acquis, si l’on en juge par les réactions mitigées de celles et ceux qui ont lu la version originale, et par le roman lui-même. Caledonian Road est complexe, long (plus de 600 pages), ambitieux et ambigu, imposant dans son objet et quelquefois (malheureusement) inégal dans son exécution. Il faut suivre, et ce n’est pas toujours facile. Mais Andrew O’Hagan n’a certainement pas voulu écrire quelque chose de plaisant ou de consensuel. Il n’a certainement voulu écrire quelque chose de facile.
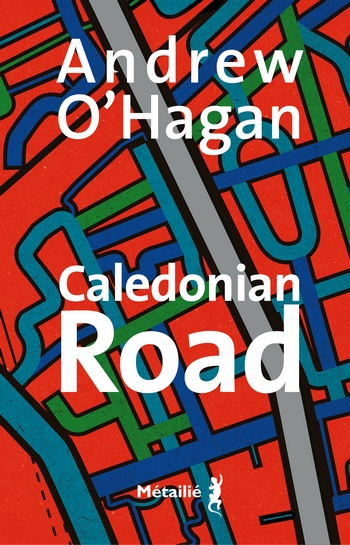 Narrativement, le roman se présente comme une fresque ample et chorale, et pourrait être une version moderne du roman social anglais du XIXᵉ siècle. La prose est (très) dense, rythmée, marquée par un goût du détail (un peu trop poussé) et une construction très théâtrale des scènes. Des phrases souvent chaotiques. Des paragraphes qui partent un peu dans tous les sens. Des dialogues quelques fois drôles, souvent très décalés, quelquefois incompréhensibles (aussi très travaillés, on sent la construction et l’artificialité, et souvent l’auteur derrière chaque réplique). Il y a une multitude de personnages, qui peut finir par perdre le lecteur ; surtout que certains ne semblent être que des figures satiriques. Et cela dure pendant plus de six cents pages, et que la trame perd un peu de consistance vers la fin, se délitant un peu dans une accumulation d’événements et de rebondissements un peu prévisibles. Le final paraît moins maîtrisé. Tout ceci est vrai, mais il y a la satire et la méchanceté. Ce qui sauve tout. Il faut prendre conscience de ce second degré pour apprécier le roman.
Narrativement, le roman se présente comme une fresque ample et chorale, et pourrait être une version moderne du roman social anglais du XIXᵉ siècle. La prose est (très) dense, rythmée, marquée par un goût du détail (un peu trop poussé) et une construction très théâtrale des scènes. Des phrases souvent chaotiques. Des paragraphes qui partent un peu dans tous les sens. Des dialogues quelques fois drôles, souvent très décalés, quelquefois incompréhensibles (aussi très travaillés, on sent la construction et l’artificialité, et souvent l’auteur derrière chaque réplique). Il y a une multitude de personnages, qui peut finir par perdre le lecteur ; surtout que certains ne semblent être que des figures satiriques. Et cela dure pendant plus de six cents pages, et que la trame perd un peu de consistance vers la fin, se délitant un peu dans une accumulation d’événements et de rebondissements un peu prévisibles. Le final paraît moins maîtrisé. Tout ceci est vrai, mais il y a la satire et la méchanceté. Ce qui sauve tout. Il faut prendre conscience de ce second degré pour apprécier le roman.
Tout tourne autour de Campbell Flynn, un parfait pseudo-héros contemporain : professeur d’université, célébrité médiatique, archétype de cette gauche libérale universitaire si fréquente aujourd’hui, ouvert à toutes les évolutions et à toutes les idées, parfaitement progressiste, faussement idéaliste, pas vraiment cynique, mais trop (ridiculement) sûr de lui, de sa stature morale et de ses capacités intellectuelles, et surtout totalement imbu de sa personne, convaincu d’avoir tout compris, d’avoir raison. Il prend les vessies pour des lanternes et voit le doigt au lieu de regarder la lune. Il est pathétique (la scène dans laquelle il trouve le nom d’un parfum est terrible). Pour couronner le tout, il aime le pouvoir et le prestige, ce qui lui fait perdre tout sens critique, toute décence, toute responsabilité. Son opportunisme, ses compromis éthiques le perdent.
Andrew O’Hagan n’est en réalité pas trop intéressé par Campbell Flynn, mais davantage par ce qu’il représente, cette société persuadée d’être à l’abri de tout parce que « cultivée », « lucide », « progressiste ». Qui n’est préoccupée que par elle-même, qui n’aime qu’elle-même comme Flynn s’aime. Voilà le sujet : le naufrage moral d’une époque, la déchéance d’une élite « progressiste » qui a cessé de l’être.
Et ce qui représente le mieux cette chute, c’est Londres (dont la représentation est certainement l’un des aspects les plus réussis du roman) : une ville dévorée par l’argent étranger, colonisée par des capitaux russes, chinois, arabes, où les biens immobiliers de luxe deviennent symboles d’une politique et d’une culture vides. Une Londres sans centre moral, où les universités se vendent au plus offrant, où les intellectuels se perdent dans la médiatisation et la visibilité sur les réseaux sociaux, et où la frontière entre « élite progressiste » et « pouvoirs en place » disparaît totalement.
Caledonian Road est un roman nécessaire, car il parle d’un sujet crucial, délicat, parfaitement contemporain : le rapport entre culture et pouvoir, moralisation et compromis, responsabilité intellectuelle et engagement politique et public. Il ridiculise ces figures qui devraient être centrales dans notre société qui ont cru être ouvertes parce qu’elles s’ouvraient à tout, acceptaient tout. Caledonian Road ridiculise les travers les plus terrifiants de nos sociétés. Cela peut irriter (on se voit dans le miroir). Mais ce n’est pas la faute d’Andrew O’Hagan si nous avons fini par faire n’importe quoi. La lecture de ces six-cent cinquante pages vaut le temps et l’énergie qu’on y consacre.
![]()
Alain Marciano
