L’Éducation physique est le premier roman traduit en français de Rosario Villajos, couronné du prestigieux prix Biblioteca Breve en Espagne. L’écrivaine madrilène prend le contre-pied de l’éducation sentimentale des hommes, très présente dans la littérature depuis Flaubert, et propose une éducation physique pour les adolescentes dans un texte féministe qui fait comprendre de façon viscérale ce que c’est de naître dans le corps d’une femme, un corps scruté, sexualisé, convoité, méprisé, moqué, constamment sur le qui-vive face à une possible menace.

Un soir de l’été 1994, Catalina, 16 ans, quitte précipitamment la maison de sa copine et décide de rentrer seule chez elle. Il n’y a plus de bus, elle part à pied et décide de faire du stop. Elle est terrifiée à l’idée de monter dans la voiture d’un inconnu, mais pas autant que ce qu’elle imagine qui l’attend si elle ne respecte pas le couvre-feu strict imposé par ses parents.
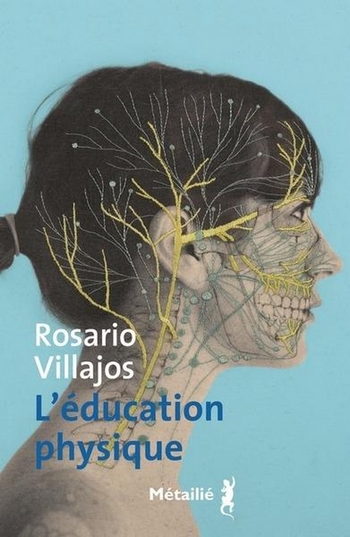 Rosario Villajos a imaginé un dispositif narratif très pertinent pour suivre les pensées de cette jeune fille sur une période de quatre heures seulement. Elle exploite à fond cette capsule temporelle en ponctuant son texte de petites horloges qui, en égrenant le temps qui passe de 18h15 à 21h45, crée un suspense digne d’un thriller. Car plane comme une menace un drame très médiatisé qui a traumatisé l’Espagne en 1993 : le meurtre de trois adolescentes originaires d’Alcàsser, près de Valence.
Rosario Villajos a imaginé un dispositif narratif très pertinent pour suivre les pensées de cette jeune fille sur une période de quatre heures seulement. Elle exploite à fond cette capsule temporelle en ponctuant son texte de petites horloges qui, en égrenant le temps qui passe de 18h15 à 21h45, crée un suspense digne d’un thriller. Car plane comme une menace un drame très médiatisé qui a traumatisé l’Espagne en 1993 : le meurtre de trois adolescentes originaires d’Alcàsser, près de Valence.
« Papa et maman la tiennent au bout d’une corde depuis longtemps rompue, car si Catalina fait du stop ce n’est pas juste pour éviter de rentrer trop tard à la maison, c’est aussi parce qu’elle a besoin de frôler la ligne rouge, de vire à la frontière ; elle préfère l’apocalypse au liquide amniotique dans lequel elle flotte quand elle est avec papa et maman. L’autostop, c’est le sport extrême qu’elle a choisi, comme d’autres filles choisissent de coucher avec des inconnus sans protection ou de rentrer seules le soir, un rite initiatique dont elle espère sortir avec un nom, un vrai, pas celui qu’on lui a imposé qui est ennuyeux comme la pluie. Ceci dit, elle espère tomber sur quelqu’un d’aussi gentil que la dernière fois pour la ramener. »
Durant ces quatre heures, le lecteur est complètement embarqué aux côtés de Catalina qui revit plusieurs épisodes marquants de sa vie, totalement immergé dans ses pensées qui se bousculent, transformant l’expérience intime de cette jeune fille en tentative de comprendre son corps. Rosario Villajos parvient à rendre palpable toute la tension, au bord de l’oppression, de cette plongée psychologique
On ressent la rage contenue nourrie de frustration de Catalina. Son regard ne laisse rien au hasard : amis, professeurs et surtout famille, avec une mère qui la conduit à un mépris obsessionnel du corps sur fond de catholicisme conservateur, un père distant qui accentue l’insécurité et un frère qui ne sera jamais son allié, autorisé à tellement plus qu’elle en tant que garçon.
« Maman ne mentionnait jamais cette partie du corps, elle la faisait simplement disparaître du langage comme une fillette dans le coffre d’une voiture, un petit lapin ou ou chat dans un haut-de-forme. Un jour, Catalina l’avait justement appelé comme ça, le « minou », pour demander à maman d’être plus douce, car elle était en train de lui laver cette zone avec un peu trop de fougue pour lui rendre sa pureté ou peut-être pour voir si elle arrivait à l’effacer pour de bon. Le minou. Catalina avait entendu une petite fille le dire à l’école. Elle n’avait alors que sept ans, et avait à peine prononcé ce mot qu’elle reçut une tape sur la bouche d’où venait de sortir ce que maman considérait comme une horreur. Le coup resta gravé comme un souvenir d’enfance : direct et sec, et si c’était possible, elle pourrait presque en sentir encore le goût aujourd’hui sur ses gencives. Le même genre de coups que certains flanquent à leur petit chien pour l’empêcher de mordre. Assez mou pour ne pas lui fendre la lèvre, mais suffisamment fort pour qu’elle ne retente jamais de nommer l’innommable. Elle ne pleura pas, mais eut les larmes aux yeux. Elle resta stoïque en serrant la bouche, sonnée, paralysée, nue et pleine de savon face à maman jusqu’à ce que celle-ci sorte de la salle de bains. »
Quand il n’y a aucune éducation sexuelle, quand MeToo n’a pas encore mis sur le devant les notions de consentement, le corps de la jeune fille est un fardeau en proie à une double insécurité, publique et privée, sociale et familiale. Nous sommes faits de matière organique. C’est le corps qui raconte l’histoire de Catalina (une opération chirurgicale, les premières règles, les seins qui poussent, le désir), un corps qui en sait plus qu’elle sur elle tellement elle est déconnectée de lui. Rosario Vilajos a gommé toute sentimentalité pour se concentrer sur les sensations physiques.
Le livre est éminemment féministe, rendant parfaitement compte du corps féminin comme champ de conflit émotionnel, affectif et politique. Il a beau être très ancré dans les années 1990 grâce à de nombreuses références (Nirvana, Twin Peaks, la peur du sida), la quête de liberté de Catalina pour en finir avec la culpabilité d’être une femme n’en est pas moins universelle et résonne fort en 2025. C’est rare de lire un texte aussi incisif – et dérangeant – questionner, avec intelligence et subtilité, la féminité, les stéréotypes sexistes, la pression sociale, la misogynie ordinaire sous toutes leurs nuances.
![]()
Marie-Laure Kirzy
