Décédé en 2003, Frédéric Berthet laisse derrière lui une œuvre rare et précieuse. Entre érudition espiègle et élégance désinvolte, ses chroniques littéraires révèlent un écrivain singulier, amateur de digression, amoureux des livres, et pourfendeur des convenances.

Frédéric Berthet est mort de ce qu’il n’a pas vécu. À 49 ans, un jour de Noël. Et pas d’une overdose de Mon Chéri. Peu importe l’année. C’était bien trop tôt. « Avec la maladie, la santé se repose. ». Cette citation suffit à placer le bonhomme dans la catégorie des écrivains remarquables, revenus de tout à force de trouver son bonheur nulle part.
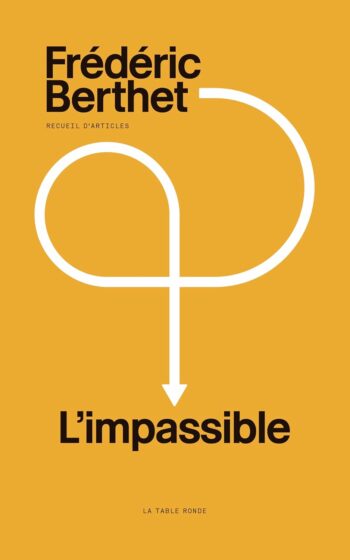 Citer Berthet dans un dîner mondain donne un certain genre. Sortir un exemplaire usé par les relectures de Daimler s’en va des poches d’une veste, est un sésame d’excentricité pour la snoberie à bulles dans le grand monde. C’est comme déclamer du Péguy pour un homme politique sur un perchoir ou dans un meeting.
Citer Berthet dans un dîner mondain donne un certain genre. Sortir un exemplaire usé par les relectures de Daimler s’en va des poches d’une veste, est un sésame d’excentricité pour la snoberie à bulles dans le grand monde. C’est comme déclamer du Péguy pour un homme politique sur un perchoir ou dans un meeting.
Au-delà des apparences, même un casanier dans mon genre, qui fait souvent rimer dîner et corvée, rallye et ennui, entracte et patraque, ne peut qu’être impressionné par la finesse du style de Frédéric Berthet. Sa plume avait de la classe. On peut la laisser nous caresser sans être obligé de faire ensuite le paon avec.
Des textes courts, qui allient humour et profondeur, des titres qui titillent la curiosité, des digressions d’aération de l’esprit et une passion dévorante pour la littérature. Tout ce qui manque à une quatrième de couverture ou à un résumé de l’histoire.
Ses adorations sont contagieuses. Après ses chroniques, impossible de ne pas foncer dans la première librairie ouverte pour réclamer un Moravia, mendier un Carver, emprunter un Julien Green ou voler un Bellow. Certains de ses textes relèvent plus du prosélytisme que de la chronique. Un exemple ? Salinger.
« …on ne devrait pas adresser la parole aux gens qui n’ont pas lu tous ses livres. Dans les dîners, on refuserait de leur passer le sel. Au restaurant, on les placerait toujours à la table placée à côté des toilettes. Pour eux, les hôtels afficheraient perpétuellement complet… »
Ses mots élogieux m’ont presque convaincu d’essayer de lire des auteurs qu’il admirait et que j’ai soigneusement évités jusque-là, comme Sollers ou Raspail.
L’autre intérêt de ce recueil réside dans les chroniques consacrées à des auteurs qui faisaient l’actualité à la fin des années 80 et qu’on ne retrouve aujourd’hui que dans des boîtes à livres ou des bibliothèques de maisons de campagne aux tapisseries jaunies. Je ne citerai pas de noms, inutile d’insister. Cela me permet de relativiser un peu certains coups de coeur du moment. Les succès d’aujourd’hui seront mes amnésies de demain.
Le dandy mérite qu’on parle de lui sans tenue de soirée. On peut le lire avec un vieux tee-shirt (si, si, celui que sa femme veut jeter depuis dix ans !), bermuda et Birkenstocks sans faute de goût… sauf si on met des chaussettes avec les Birkenstocks, mais à ce stade, on ne peut plus rien faire pour vous.
Avec ce bel objet, numéroté s’vous plait, la masse critique ne peut pas mieux porter son nom et je remercie sincèrement les éditions de La Table Ronde pour la sélection des lectures et chroniques littéraires qui composent cette revue de presse empressée.
Le titre burlesque de l’un des articles que j’ai beaucoup aimé pour finir et souligner l’importance de l’humour chez Berthet : le cri du gardon dans Berlin-Ouest.
![]()
Olivier de Bouty
