L’auteur à succès Michel Bussi revient non pas avec un polar, genre qui en a fait un des auteurs les plus vendus en France, mais avec un roman historique, ou plutôt une fiction à suspense dont l’intrigue est fondée sur une réalité historique, le génocide rwandais, avec un éclairage passionnant sur l’implication de l’État français.

Maé, quinze ans, vient de recevoir un magnifique cadeau de la part de son grand-père et de sa mère ; elle qui va réaliser son rêve absolu: un safari pédestre dans les montagnes des Virunga pour observer les gorilles. La famille a un lien très fort avec le Rwanda. C’est là que son grand-père Jorik, alors capitaine français en mission dans le pays, a rencontré sa grand-père Espérance. C’est là qu’est née sa mère Aline, pays dans lequel elle n’est jamais retournée depuis le génocide, depuis la disparition de sa mère tutsi, elle avait trois ans. Jorik lui remet un dernier cadeau en cachette d’Aline : le journal de sa grand-mère Espérance, tenu de 1990 jusqu’à sa mort. Il lui avoue également que s’il n’est jamais revenu au Rwanda avant, ce n’est pas uniquement pour fuir ses pires souvenirs mais parce qu’il n’y était pas forcément le bienvenu. Le passé va vite les rattraper.
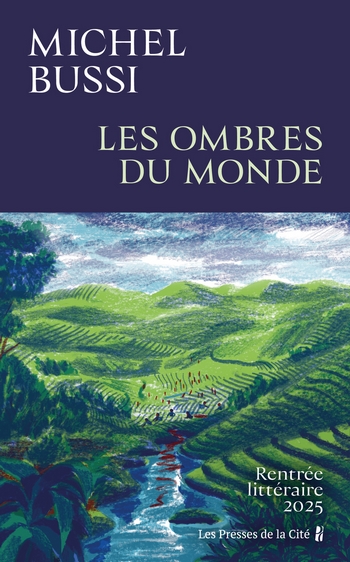 Un roman historique, évoquant une des pires tragédies du XXème siècle, écrit par un auteur de best-sellers… forcément, certains se pinceront le nez, d’autres se questionneront sur sa légitimité et sa capacité à aller au bout d’un tel projet. Ils ont tort.
Un roman historique, évoquant une des pires tragédies du XXème siècle, écrit par un auteur de best-sellers… forcément, certains se pinceront le nez, d’autres se questionneront sur sa légitimité et sa capacité à aller au bout d’un tel projet. Ils ont tort.
Michel Bussi a été enseignant chercheur à l’université de Rouen pendant vingt-cinq ans, spécialiste en géographie politique ; il a travaillé de façon approfondie sur le génocide rwandais, constituant dès 1994 un corpus documentaire sur le sujet. De plus, Les Ombres du monde a été relu par de nombreux spécialistes, notamment le journaliste Patrick de Saint-Exupéry qui l’a accompagné étroitement, gage de rigueur historique.
Le génocide rwandais est connu du grand public français dans ses très grandes lignes : en seulement cent jours d’avril à juillet 1994 un million de Tutsis massacrés à la machette par des extrémistes Hutus, le groupe ethnique majoritaire au Rwanda ; la radio des Mille Collines qui a diffusé la haine et encouragé à l’extermination des « cafards » et « cancrelats ». Pour le grand public, il y a eu Corneille et sa chanson Parce qu’on vient de loin, il y a eu Gaël Faye avec Petit Pays et Jacaranda.
Qui se souvient des débuts du génocide rwandais ? Une des grandes qualités des Ombres du monde est de replacer le récit dans sa dimension géopolitique en remontant aux origines du génocide, à ses prémisses. Chronologiquement, les quatre années qui l’ont précédé sont exposées avec une grande clarté. Et on est sidérés de découvrir que tout était déjà écrit avec la montée du Hutu Power et des extrémistes de l’Akazu qui vont organisés le génocide, des proches du président Juvénal Habyarimana. Michel Bussi ne cherche pas à édulcorer la réalité, certaines pages sont très dures.
Et on est encore plus sidérés de découvrir l’étendue des implications de l’État français, François Mitterrand entretenant une relation privilégiée avec le président rwandais hutu dès 1990 : livraison d’armes, formation militaire, mercenaires alliés aux futurs génocidaires avant le drame, jusqu’au fiasco de l’opération Turquoise incapable de protéger les Tutsis, puis un déni du génocide (proche de l’omerta) qui a perduré, la ligne officielle préférant parler de guerre interethnique pendant très longtemps. Ce n’est qu’en 2021 qu’une commission de chercheurs présidée par Vincent Duclert a parlé de « responsabilités lourdes et accablantes » de la France tant elle a été aveugle à la préparation génocidaire.
Dans chaque page, on sent la conviction de l’auteur à vouloir sensibiliser des lecteurs peu informés de la complexité de ce génocide. Et c’est là qu’il met la puissance de la fiction au service de cette volonté profonde.
Michel Bussi a peut-être troqué le polar pour le roman historique, il n’abandonne pas pour autant son savoir-faire en la matière. Son récit mêle de façon très habile fiction romanesque et réalité historique. Ici le génocide est raconté à hauteur de femmes et d’hommes, sans effet de style mais avec une écriture simple et directe qui privilégie l’efficacité narrative et l’émotion.
L’auteur aime jouer avec les certitudes de ses lecteurs, truffant son récit de rebondissements inattendus, de faux-semblants, de secrets révélés, ici autour du mystère de l’attentat du 6 avril 1994 (dans lequel meurt, entre autres, le président rwandais, son Falcon abattu en plein vol au-dessus de Kigali) qui a entraîné un coup d’état par les extrémistes hutus et a fourni le prétexte au génocide. Michel Bussi maîtrise totalement l’alternance passé (avec des extraits du journal de la grand-mère Espérance de 1990 à 1994) et présent de 2024 (aux côtés de sa petite-fille et de sa fille). Il y a sans doute quelques rebondissements et cliffhangers de trop, quelques ficelles apparentes, mais le suspense happe implacablement.
Et derrière cette fiction construite comme un thriller page turner se dessine une réflexion sur la transmission de la mémoire. Les rebondissements, même ceux de « trop », sont de puissants révélateurs de l’expérience de la violence, de la perte et du pardon, incarnée par des personnages attachants aux côtés desquels il est aisé de s’investir et de se projeter dans leur quête d’identité et de vérité. .
Comme Olivier Norek qui lui aussi avait osé le roman historique (Les Guerriers de l’hiver, 2024), le pari est réussi pour Michel Bussi.
![]()
Marie-Laure Kirzy
