Six ans après un premier roman incandescent qui l’avait érigé en porte-voix de la communauté amérindienne aux Etats-Unis, Tommy Orange revient et comble une nouvelle fois les lacunes de la mémoire en déployant, du XIXe siècle à aujourd’hui, l’histoire déchirante d’une famille amérindienne qui s’efforce de retrouver le chemin de la vie, au-delà de l’héritage traumatique des guerres indiennes et de l’assimilation culturelle forcée.

Les Étoiles errantes est à la fois un préquel et une suite d’Ici n’est plus ici, mais peut-être lu indépendamment. Même lieu, Oakland en Californie (d’où est originaire l’auteur), même choralité narrative, mêmes personnages de descendance cheyenne, notamment le jeune Orvil grièvement blessée par balle lors d’un pow-wow à Oackland, sa grand- tante Opale Viola Bear Chield qui l’a élevé ainsi que ses deux petits frères après le suicide de leur mère, et leur grand-mère Jacquie Red Feather qui cherche à sortir de son alcoolisme.
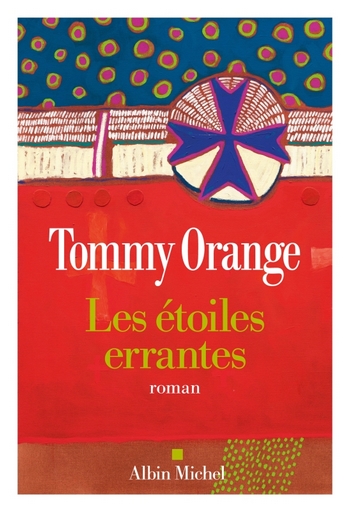 L’intrigue d‘Ici n’est plus ici gravitait autour du pow-wow d’Oakland. Cette fois, Tommy Orange propose carrément une saga familiale balayant 150 ans soit sept générations des Bear Shield / Red Feather., avec en toile de fond une question lancinante : qu’est-ce qu’être indien aujourd’hui aux États-Unis, qu’est-ce que cela signifie ?
L’intrigue d‘Ici n’est plus ici gravitait autour du pow-wow d’Oakland. Cette fois, Tommy Orange propose carrément une saga familiale balayant 150 ans soit sept générations des Bear Shield / Red Feather., avec en toile de fond une question lancinante : qu’est-ce qu’être indien aujourd’hui aux États-Unis, qu’est-ce que cela signifie ?
Court mais percutant, le prologue militant ancre le récit dans la réalité historique des guerres indiennes du XIXème siècle en attirant l’attention sur leurs conséquences immédiates, moins connues que les tueries de masse ou le parquage dans les réserves. Le slogan « Tuez l’indien pour sauver l’homme » a été mis en pratique très concrètement avec la création de prisons de « rééducation » comme celle de Fort Marion en Floride (1875) dirigée par le capitaine Pratt, expérience qui l’inspira pour créer la Carlisle Indian Industrial School (1879), pensionnat pour enfants indiens arrachés à leur foyer où un endoctrinement violent leur inculquait que tout ce qui était indien était mal.
La première partie « Origines » revient sur cette douloureuse période en racontant le vécu des ancêtres cheyennes de la famille Bear Shield / Red Feather, avec comme événement fondateur le massacre de Sand Creek (Colorado-1864) et comme fin 1924 date à laquelle les guerres indiennes ont été officiellement déclarées terminées. Tommy Orange passe le relais à différents personnages dans un récit fragmenté qui court de l’un à l’autre, fonctionnant par précipités, par flashs qui ne rendent pas compte de la totalité de leur vie mais forent dans leurs souffrances au moment où elles ont été le plus aiguës. Ces 150 pages ne sont pas toujours aisées à suivre mais leur flux désordonné et discontinu dit avec force toute la mémoire indienne qui a été définitivement perdue pour les descendants durant cette période.
Les deux parties qui suivent propulsent le lecteur en 2018 auprès des descendants : trois frères adolescents élevés par leur grand-tante depuis le suicide de leur mère toxicomane, avec une grand-mère en quête de sobriété, une famille bouleversé par la blessure par balle de l’aîné lors du pow-wow d’Oakland dans lequel tous était présent. Le récit ralentit pour laisser place à une plus grande profondeur psychologique
On sent à quel point Tommy Orange aime ses personnages. Chacun lutte pour ne pas être aspiré par le cycle ancestral de cette violence intergénérationnelle initiée par les guerres indiennes et des décennies d’assimilation forcée, se sentant étranger dans leur propre pays. Chacun d’eux est une étoile errante qui cherche à reconstruire une identité brisée, aux prises avec des batailles personnelles. Le plus touchant est incontestablement le plus jeune des frères, Lony, qui s’invente des rituels autour du sang et de l’automutilation, tentative naïve d’une enfant qui cherche à se relier à ses origines indiennes dont on l’a privé, depuis qu’il a lu sur Internet que le nom « Cheyennes » signifie les « scarifiés ». Ou s’interroge pour savoir quels seraient les pouvoirs d’un superhéros indien s’il existait dans la culture pop.
Chaque voix touche, interpelle, fait craindre, bouleverse, fait écho à la précédente ou va le faire avec la suivante. L’auteur orchestre avec brio cette constellation chorale pleine de chagrin et de mélancolie, proposant ainsi un portrait kaléidoscopique de l’identité amérindienne urbaine au XXIème siècle.
« J’ai toujours eu l’impression qu’on ne s’en est pas assez bien sortis. Que notre lignée familiale est faible, d’une certaine façon. Affaiblie par les effets du passé, de la colonisation, du traumatisme intergénérationnel. Mais aussi pas suffisamment forte pour transmettre avec succès sa langue ou ses traditions.Parce qu’il nous manque quelque chose. (…) Survivre ne suffit pas. Traverser les épreuves ne faisait que renforcer nos capacités d’endurance. Le simple fait de durer, c’est bon pour une muraille, une forteresse, mais pas pour un être humain. »
Le constat est sombre, très sombre (avec quelques redondances et longueurs concernant l’addiction aux drogues) mais jamais désespéré ni désespérant. La lumière vient de passages poétiques absolument superbes qui ouvrent l’âme des personnage, révélant autant leur beauté que des cicatrices persistantes. Les étoiles scintillent peut-être faiblement mais elles le font. On aperçoit leur lumière au loin pour guider les personnages, une lumière qui ne peut naître que de l’amour tendre que se portent les membres d’une famille, un « type d’amour qui survit à la survie » au-delà de la somme des douleurs de chacun.
![]()
Marie-Laure Kirzy
