Erik Larson nous fait revivre les cinq mois charnières qui séparent l’élection d’Abraham Lincoln (novembre 1860) du début de la guerre de Sécession (avril 1861), une crise lente qui a finalement déchiré en deux une nation profondément divisée, éprouvant les fragilités d’une démocratie confrontée à la peur et à l’extrémisme. Et en creux, il nous offre également l’occasion d’une passionnante réflexion sur l’époque actuelle, plus précisément sur les tumultes politiques que connaissent les États-Unis.

De la guerre de Sécession (1861-1865), le lecteur français connaît en général les enjeux autour de l’esclavage, quelques personnages clefs comme le président Abraham Lincoln, les généraux Lee (côté Confédérés) ou Grant (coté Unionistes), et bien sûr le dénouement avec la victoire des Nordistes sur les Sudistes avec comme effet immédiat l’abolition de l’esclavage. Mais quid de son déclenchement et du contexte explosif qui l’a précédée ?
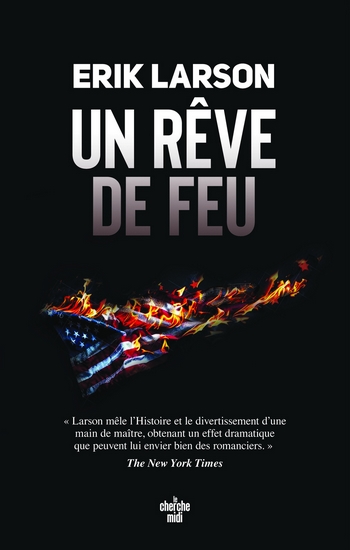 Comme en témoigne la bibliographie de fin, Erik Larson s’est plongé dans un corpus de sources assez impressionnant : télégrammes, lettres personnelles, journaux intimes, archives militaires et parlementaires, articles de presse. Avec une documentation aussi riche, le risque était de proposer un récit difficilement digeste pour le non-historien. Certes, il faut se concentrer, surtout si on a peu de connaissances sur la guerre de Sécession, le récit est dense en détails mais il est surtout très immersif.
Comme en témoigne la bibliographie de fin, Erik Larson s’est plongé dans un corpus de sources assez impressionnant : télégrammes, lettres personnelles, journaux intimes, archives militaires et parlementaires, articles de presse. Avec une documentation aussi riche, le risque était de proposer un récit difficilement digeste pour le non-historien. Certes, il faut se concentrer, surtout si on a peu de connaissances sur la guerre de Sécession, le récit est dense en détails mais il est surtout très immersif.
C’est très facile de se laisser porter par la narration car elle injecte du romanesque, ce qui la rend lisible. Si Erik Larson réussit à trouver l’équilibre juste entre détails au microscope et plan d’ensemble, c’est parce qu’il concentre son récit sur des personnages clefs pris dans un écheveau mêlant ambition-orgueil-trahisons-malentendus-doutes-erreurs tragiques : Abraham Lincoln, élu président presque par surprise en novembre 1860, investi seulement en mars 1861, que l’on suit impuissant à empêcher onze États sudistes à faire sécession les uns après les autres, obligé de se grimer lors son voyage en train de l’Illinois vers son investiture à Washington tant les risques d’assassinat sont grands ; Edmund Ruffin, planteur activiste radical et sanguinaire, attisant l’ardeur sécessionniste ; ou encore Mary Chesnut, fine diariste décrivant avec intelligence et mordant la société des planteurs de Caroline du Sud.
Mais le vrai héros du récit, c’est le major Anderson. C’est lui qui a tenu le fort Sumter, en Caroline du Sud. Épicentre de la tragédie, cette bataille a marqué le début officiel de la guerre de Sécession. Le personnage est passionnant, déchiré entre des affinités personnelles avec le Sud -en tant qu’ancien esclavagiste- et sa loyauté inflexible vis-à-vis de l’armée fédérale : il a été assiégé avec ses 80 hommes pendant des semaines sans aucune directive officielle claire sur les positions à tenir, rendre le fort fédéral aux Confédérés de Beauregard ou ouvrir le feu, ce qui deviendrait à déclencher la guerre que tout le monde appréhendait.
Au final, on ressort avec une connaissance fine des mécanismes qui ont pu conduire la république américaine à une catastrophe voyant s’entretuer près de 750.000 concitoyens. Et ce sans jamais donner de leçon ou indiquer au lecteur quoi penser, même si on dévine aisément la position de l’auteur. A l’heure de l’ère Trump post 6 janvier 2021 et de l’assaut du Capitole par ses partisans pour contester les résultats d’une élection présidentielle légitime, alors que « certains Américains aveuglés par l’ignorance » se sont mis à reparler à mi-voix de sécession et de guerre civile à venir, forcément le récit d’Erik Larson résonne.
Sans doute aurait-il encore plus résonner s’il avait donné la parole au peuple et notamment aux Afro-américains, qu’ils soient esclaves dans les États sudistes ou libres dans le Nord. Une représentativité moins élitiste et blanche aurait donner plus de puissance à l’exposition des prémisses de la guerre de Sécession et au choc des perceptions morales antagonistes dans lequel couve la haine, permettant ainsi à une violence terrible de devenir imaginable.
![]()
Marie-Laure Kirzy
