Au cœur d’une orgie mondaine où l’on chante pour les puissants, Navad Lapid oppose la traversée nue d’un désert moral : comment encore regarder – et filmer – la guerre sans obscénité ? De la transe tel-avivienne à la frontière, Oui fouille la compromission jusqu’au clip-propagande qui retourne l’art contre lui-même.

« Résigne toi : la soumission, c’est le bonheur ». Dans Le Genou d’Ahed, le personnage, un cinéaste nommé Y, s’échinait à communiquer autour des violences à l’égard des Palestiniens, en dépit de nombreuses pressions, qui finissaient par avoir presque raison de son œuvre. Le protagoniste de Oui a le même nom, cette simple lettre qui semble hurler un why à l’échelle internationale, et s’est désormais entièrement résigné. Avec son épouse, il est une « pute des puissants », dit « Oui » à toutes les propositions, et anime leurs soirées décadentes où il danse et chante pour le bonheur des nantis ravis d’avilir les individus à leur botte. La parole n’a plus sa place : on vocifère en laissant sa voix s’effacer derrière le fracas d’une musique ringarde, la langue n’articule plus, elle lèche les orifices, la bouche ne prononce plus, elle boit, suce et vomit.
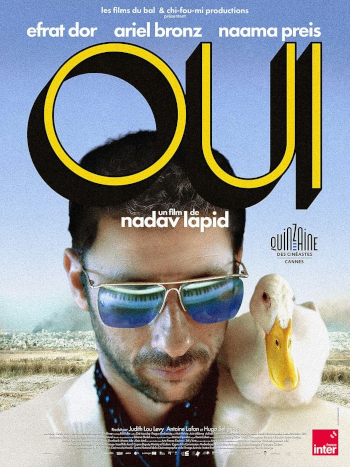 Navad Lapid n’a plus les mots pour verbaliser l’état des lieux d’une nation pétrie par la haine d’un voisin, qui l’a avilie dans la barbarie. Alors, la caméra danse, s’agite jusqu’à la nausée, prend le pouls d’une société malade où il faut s’aveugler pour ignorer le sort fait au-delà des murs, où il faut se compromettre pour en tirer profit. L’euphorie continue commence comme la fête inaugurale de La grande belleza, avec cette même distance ironique qui tresse à l’allégresse des relents croissants d’obscénité. De l’art, il ne reste presque plus rien, si ce n’est des versions dénaturées des toiles de George Grosz, ou la reproduction grotesque de figures mythologiques (le cyclope qui projette des images, l’ouroboros, serpent circulaire où chacun lèche les pieds de son supérieur). Les chansons virent à la bataille rangée, dans un pays qui hurle le ralliement patriote, au point d’accuser jusqu’au spectateur d’être contre l’État d’Israël : la guerre rallie le show, qui doit continuer, puisque c’est là que la collectivité se soude, que le groupe se saoule pour ne pas regarder frontalement ce que les bombardements de la vengeance impliquent.
Navad Lapid n’a plus les mots pour verbaliser l’état des lieux d’une nation pétrie par la haine d’un voisin, qui l’a avilie dans la barbarie. Alors, la caméra danse, s’agite jusqu’à la nausée, prend le pouls d’une société malade où il faut s’aveugler pour ignorer le sort fait au-delà des murs, où il faut se compromettre pour en tirer profit. L’euphorie continue commence comme la fête inaugurale de La grande belleza, avec cette même distance ironique qui tresse à l’allégresse des relents croissants d’obscénité. De l’art, il ne reste presque plus rien, si ce n’est des versions dénaturées des toiles de George Grosz, ou la reproduction grotesque de figures mythologiques (le cyclope qui projette des images, l’ouroboros, serpent circulaire où chacun lèche les pieds de son supérieur). Les chansons virent à la bataille rangée, dans un pays qui hurle le ralliement patriote, au point d’accuser jusqu’au spectateur d’être contre l’État d’Israël : la guerre rallie le show, qui doit continuer, puisque c’est là que la collectivité se soude, que le groupe se saoule pour ne pas regarder frontalement ce que les bombardements de la vengeance impliquent.
À la collectivité, Lapid oppose donc l’intimité d’un couple, dont la vie fracturée (putes la nuit, parents le jour) symbolise une nation déchirée. Leur fils, né le 8 octobre, est la ligne d’horizon d’un pays qui devra à l’avenir répondre de l’Histoire qu’il a écrite, et que sa mère prévoit d’élever ailleurs, dans une autre langue, sans mémoire de ses origines, pour pouvoir envisager une issue – celle, précisément, choisie par le cinéaste qui a fini par quitter Israël.
Alors qu’on propose au musicien Y de recomposer l’hymne national dans une perspective propagandiste et génocidaire, celui-ci entreprend un voyage vers la frontière, dans un segment où une certaine forme de calme s’installe, en rupture totale avec la farce inaugurale. C’est là que commence véritablement le cœur du film, qui entame une réflexion éthique sur la question de la représentation. Comment, sans obscénité, évoquer l’horreur de la guerre, et la barbarie qui souille les deux côtés de la frontière ? Par la parole, d’abord, dans un terrible monologue sur les massacres du 7 octobre. Par l’image, ensuite, mais à distance, sans représentation : loin de la ville effervescente et occidentalisée de Tel Aviv, Gaza, au milieu du désert, sous des colonnes de fumées, dans le fracas en sourdine de bombardements presque invisibles. D’autres morts invisibles, filmés en direct par Lapid, qui montre en premier plan un couple dans une autre Histoire, tentant avec maladresse de renouer avec un passé révolu. Celui de l’amour, celui d’une paix qui n’exista jamais.
La société de l’image a récupéré les images, crues, violentes, profuses, insoutenables, qui ont désormais valeur d’arguments pour justifier celles que diffuseront les opposants. Lapid refuse cette obscénité, dans un geste qui rappelle les postures de Lanzmann (Shoah), Nemes (Le fils de Saul) ou plus récemment Glazer (La Zone d’intérêt). Au-delà de la figuration, en deçà des idéologies (« J’espère que Dieu n’existe pas », dira Y), le film se ménage un cœur épuré, dans la poussière du désert.
Il faudra pourtant revenir à l’orgie citadine, et honorer ou non le pacte faustien dévoyant les fondements même de l’hymne. Et c’est dans ce geste final d’avilissement d’Y que Lapid trouve l’aboutissement de sa réflexion sur l’image. Alors que le show bat son plein, rappelant les bunnies d’Apocalypse Now et les commémorations mensongères d’Un jour dans la vie de Billy Lynn, un clip met en images et en lettres l’hymne revisité. Cet appel au génocide, entonné par des enfants, est le seul à contenir des images des bombardements, et pour cause : c’est une réutilisation à des fins de propagande, une glorification des massacres vengeurs. Dans un ultime haut-le-cœur, Lapid laisse la haine saturer un écran en abyme, et les derniers esprits lucides s’en écarter, terrassés par l’écœurement, en reflets fatigués du spectateur mené à rude épreuve. La réponse à cette débauche visuelle se situera dans le carton final, qui nous apprend que le clip est réel, et que cet hymne a effectivement été diffusé par le Front Civique, et par la télévision publique israélienne. Un texte sur fond noir, en complément des rectangles opaques barrant les visages des enfants chanteurs, pour préserver leur anonymat, et ce qui leur reste encore peut être d’inconscience ; puis un générique, dans un silence éloquent, où l’indignation se fait dans un recueillement qui a la décence de comprendre que le cri, même chanté, n’est plus la réponse adéquate.
![]()
Sergent Pepper
