Avec Bong Joon-ho, désordre social, Erwan Desbois entreprend de raconter le cinéma du Coréen à travers de ce qu’il contiendrait de la situation des laissés pour compte du développement économique du pays. Un travail en partie maladroit, mais intéressant lorsqu’il montre comment les problématiques sociales s’incarnent dans la mise en scène et le décor des films du réalisateur palmé.

J’ai toujours ressenti une certaine méfiance par rapport au fait d’ériger un artiste en porte parole des classes populaires. Au mieux il existe des artistes dans lesquels ces dernières reconnaissent à un moment donné leur vécu, leur état d’esprit. Je suis d’autant plus sceptique dès qu’il est question d’un cinéaste coréen. Faire du cinéma au pays du matin calme y est souvent synonyme d’origines sociales aisées, à quelques exceptions près.
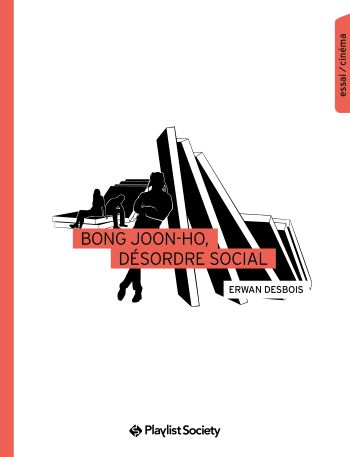 Pour autant, je ne peux rejeter l’angle choisi par Erwan Desbois dans Bong Joon-ho, désordre social : celui d’un cinéaste portant au sommet du palmarès cannois puis aux Oscars la situation des laissés pour compte. Si Parasite est un indéniable retour en forme du cinéaste après une peu convaincante expatriation, sa Palme me semble en partie liée à une synchronicité temporelle. Avec le mouvement des Gilets Jaunes d’abord. Avec une époque où, parce que la prospérité économique semble un lointain souvenir, un ressentiment vis-à-vis du sommet de la pyramide sociale souvent décrit comme un particularisme national de l’hexagone se répand chez une partie de l’opinion publique internationale. Et l’histoire a souvent montré que le lien avec les questions politiques avait souvent tendance à fédérer les jurys de grands festivals.
Pour autant, je ne peux rejeter l’angle choisi par Erwan Desbois dans Bong Joon-ho, désordre social : celui d’un cinéaste portant au sommet du palmarès cannois puis aux Oscars la situation des laissés pour compte. Si Parasite est un indéniable retour en forme du cinéaste après une peu convaincante expatriation, sa Palme me semble en partie liée à une synchronicité temporelle. Avec le mouvement des Gilets Jaunes d’abord. Avec une époque où, parce que la prospérité économique semble un lointain souvenir, un ressentiment vis-à-vis du sommet de la pyramide sociale souvent décrit comme un particularisme national de l’hexagone se répand chez une partie de l’opinion publique internationale. Et l’histoire a souvent montré que le lien avec les questions politiques avait souvent tendance à fédérer les jurys de grands festivals.
On peut déjà reconnaître une chose à l’auteur : s’il cite beaucoup Antoine Coppola, il ne reprend pas ses analyses parfois débattables sur les films coréens, juste ce que ce dernier raconte de l’impact des tumultes de l’histoire de la Corée du Sud sur la censure et le contenu des films coréens. Un des intérêts du livre est justement de raconter en accéléré une histoire du pays pour le moins agitée plus que visible dans les films produits.
Surtout, il montre que la mutation démocratique n’est pas forcément achevée dans les faits, en évoquant des soubresauts politiques récents pas toujours favorables aux libertés publiques. Il est aussi intéressant de mentionner le lien entre l’exposition de The Host et un faits divers réel, ou de rappeler la manière dont le contexte de la dictature militaire surgit par petites touches dans Memories of Murder.
La grille de lecture marxiste développée ici peut sembler lourde, voire anachronique pour un regard hexagonal. La question de l’Etat policier était une problématique d’opinion forte en France dans les années 1970, elle l’est nettement moins désormais. Mais il faut rappeler que l’on parle d’une démocratie asiatique encore jeune, et à l’échelle de l’histoire, le passé de la dictature militaire est trop récent pour avoir totalement disparu de la société.
En revanche, si une société avec la culture de compétition et le niveau d’inégalités sociales de la Corée du Sud représente du pain béni pour une grille de lecture marxiste, il y a quelque chose de forcé dans l’absence de libre arbitre développée dans le livre à propos du bas de la société coréenne (et par extension celle supposée des personnages du cinéaste). Ou sur la manière de plaquer sur l’œuvre du cinéaste le concept de lumpenprolétariat.
Et on peut se poser la question de savoir pourquoi les meilleurs films d’un cinéaste au travail imprégné du souvenir de la contestation d’extrême-gauche de la dictature ne semblent pas l’otage d’une vision des choses trop idéologique. Desbois offre une clé en signalant comment la vision politique trouve une incarnation cinématographique directe. Dans le décor notamment, avec la présence récurrente du sous-sol dans la filmographie du cinéaste bien avant Parasite.
On pourrait ajouter au livre que le sous-sol est, chez le cinéaste, un lieu dont on peut ponctuellement sortir (même si on y retourne très souvent). Et qu’il y a sans doute en partie le souvenir de La Servante, classique sixties de Kim Ki-young dans lequel les étages de la maison résidentielle évoquent le statut social de leurs occupants. Un film auquel le livre consacre d’ailleurs quelques pages. Encore plus intéressant : raconter comment la reprise d’un cadrage raconte l’évolution ou pas de la situation d’un personnage.
De plus, si on n’a jamais revisionné le premier long métrage du cinéaste (Barking Dog), on a tendance à trouver vraisemblable la comparaison faite avec Affreux, sales et méchants. Parce que l’on a toujours pensé que le point de départ de Parasite n’était pas éloigné de celui de certaines comédies italiennes des années 1960-1970. Le livre n’est, ceci dit, pas exempt de références culturelles collées au forceps sur le cinéma du Coréen (Victor Hugo, Voltaire ou Verhoeven par exemple).
Bong Joon-ho, désordre social est un livre auquel on pardonne en partie ses maladresses pour son éclairage sur une société coréenne loin d’être apaisée et ses parties focalisées sur le cinéma.
![]()
Ordell Robbie
