Éprouvant et flamboyant, Soundtrack to a Coup d’État ne se contente pas de raconter l’histoire du Congo et de la duplicité des grandes puissances : il la rejoue comme un morceau de jazz libre, syncopé et tragique.

Il faut se rendre disponible pour le morceau de bravoure qu’est Soundtrack to a Coup d’État : à sa durée (2h30), son sujet (le destin d’un pays, le Congo, et la machine à broyer des deux blocs durant la guerre froide pour étouffer dans l’œuf son indépendance), et surtout ses choix formels.
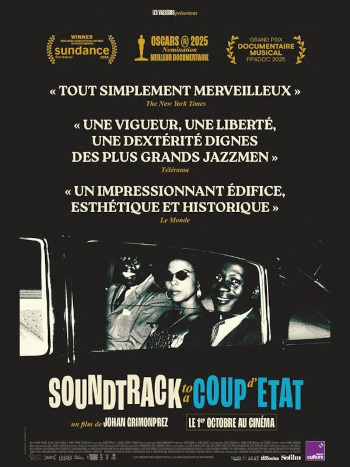 En s’intéressant à la manière dont le gouvernement américain a tenté d’instaurer un soft power noir par le biais de ses musiciens de jazz, le film épouse les audaces libertaires de cette musique pour écrire sa propre partition. Montage éclaté, narration syncopée, travail très fin sur la direction artistique, reprenant les polices et les couleurs des pochettes d’album du label Blue Note : le film EST le jazz, au risque évident, surtout dans son ouverture, de déstabiliser un spectateur habitué à un traitement plus didactique sur des enjeux aussi pluriels et complexes.
En s’intéressant à la manière dont le gouvernement américain a tenté d’instaurer un soft power noir par le biais de ses musiciens de jazz, le film épouse les audaces libertaires de cette musique pour écrire sa propre partition. Montage éclaté, narration syncopée, travail très fin sur la direction artistique, reprenant les polices et les couleurs des pochettes d’album du label Blue Note : le film EST le jazz, au risque évident, surtout dans son ouverture, de déstabiliser un spectateur habitué à un traitement plus didactique sur des enjeux aussi pluriels et complexes.
Il s’agit donc de se laisser porter, de voir passer des personnalités, des citations, des images d’archive sans pouvoir, dans un premier temps, clairement les identifier. Permettre au temps long de générer des lignes mélodiques, des motifs rythmiques destinés à se répéter, et voir éclore le théâtre presque grotesque des Nations supposément unies, où chacun fait son petite numéro : la diplomatie hypocrite des belges, les sorties tonitruantes de Khrouchtchev, le cynisme américain.
La tonalité est assez redoutable : elle mise, dans un premier temps, sur l’euphorie de la forme, dans une vision satirique du théâtre des opérations, où les puissances jouent sur l’échiquier mondial, tandis que les saltimbanques de l’expression artistique leur servent de caution pour aller séduire les populations africaines. La mise en parallèle des pourparlers et des concerts, des performances et des discours génère une forme homogène aussi enthousiasmante que risible, où l’on oppose la sincérité des artistes aux performances mensongères des diplomates.
Mais une fois le spectateur aguerri à l’exercice de style, fini de rire : le documentaire monte en puissance à mesure qu’il décape toute la mécanique illusoire du soft power, derrière lequel s’ouvre, béante, la mâchoire carnassière d’un retour à l’ordre. Le point d’orgue de l’euphorie, cette utopie d’Etats Unis d’Afrique, se fracasse alors dans une noirceur proprement révoltante, où l’on documente une guerre civile fomentée à distance, une annonce du Vietnam, en somme, avec ce caractère officieux du recours aux mercenaires.
L’indignation croissante du spectateur se construit donc dans cette progression tragique, qui transforme la musique festive en requiem, le chant en témoignage face caméra par une femme des exactions commises, et va jusqu’à couper le son face aux stridences impuissantes d’un Coltrane. Le cynisme atteint son apogée lorsqu’un mercenaire allemand explique, entre deux missions barbares, aller écouter des concerts au Goethe Institut du Congo, où l’on vante les vertus d’une musique universelle devant un parterre de colons.
Dégoût, révolte, désenchantement : ces forces obscures irriguent alors le chant final, et l’irruption d’Abbey Lincoln et Max Roach au conseil de sécurité de l’ONU, qui doit, dans ses intérieurs capitonnés, écouter pour une fois le chœur palpitant des citoyens du monde.
![]()
Sergent Pepper
