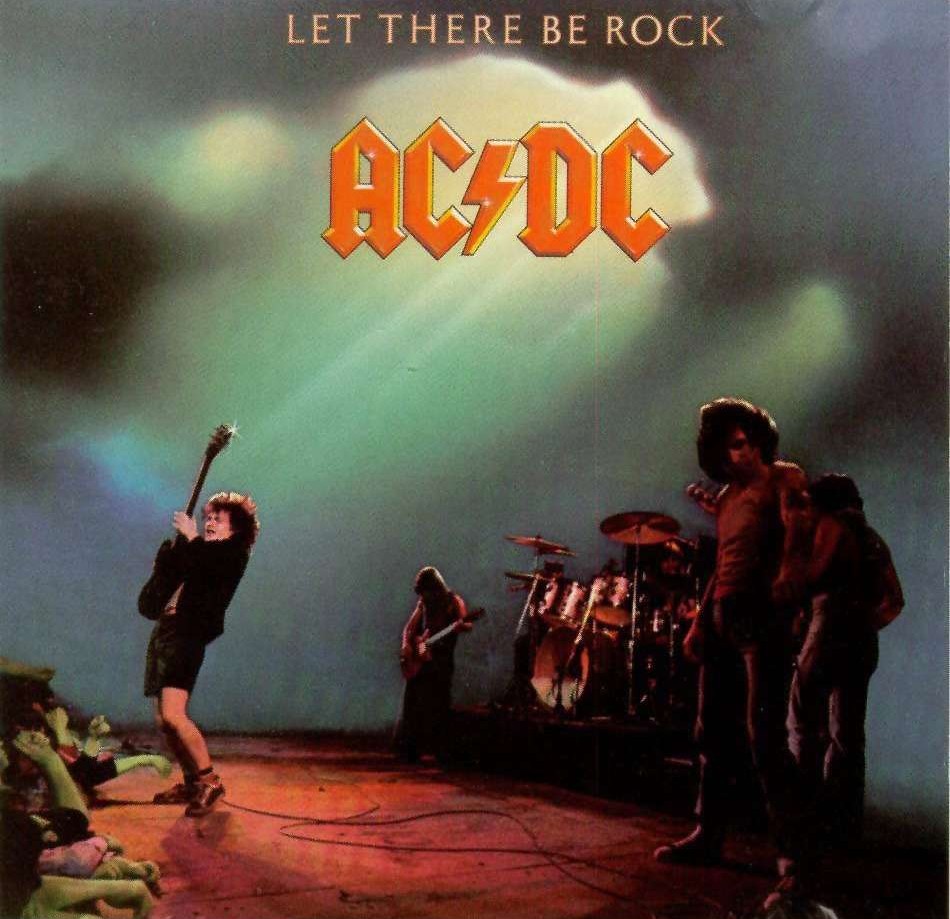Let There Be Rock débarque au beau milieu de cette vague Punk qui va soulever le monde et vient proposer autre chose aux Rockeurs du monde entier. AC/DC ne suit pas le chemin de la destruction Rock prônée par les Punks mais opte pour une rénovation, la régénération d’un Hard-Rock un peu oublié. Prouvant ainsi que le bruit et la fureur n’est pas uniquement l’apanage de la jeunesse à épingles à nourrice dans le pif et crêtes sur la tronche. Alors que le Rock soit !
En 1977, c’était le Punk qui raflait tous les suffrages du petit monde du Rock’n’Roll.
Les gamins du monde entier commençaient à déboulonner les idoles qu’ils avaient tant aimées et foutaient au feu les vinyles de papa. L’époque ne souhaitait pas s’encombrer de virtuoses aux doigts d’or ou d’intellectualisation « progressive » trop réfléchie. Ce sont les racines d’un Rock enterrées sous des tonnes de maquillage, d’effets inutiles et de lassitude « Shobiznesque », que les Punks sont bien décidés à déterrer à grands coups de pelles rouillées.
Juste l’énergie ! L’étincelle ! C’est la pureté que sont venus chercher les jeunes, l’immédiateté.
La jeunesse turbulente de la fin des sixties a laissé place à des quarantenaires bien trop expérimentés. L’urgence a laissé place à la réflexion. L’agitation adolescente au tranquille train de sénateur.
Les Rolling Stones, Led Zeppellin, Black Sabbath et consorts mènent dorénavant grand train et sont plus occupés à choisir la couleur de leur limousine qu’à faire péter les amplis et balancer la purée électrique.
En 1977, la jeunesse ne respecte plus les anciens. En 1977, la jeunesse n’a plus rien à perdre et emmerde la terre entière. On se fout des épingles à nourrices plein la tronche et de la colle liquide plein les narines ; en 1977 c’est cette vieille raclure de Johnny Rotten qui se balade avec un t-shirt « I Hate Pink Floyd » en faisant un doigt – salvateur ? – aux ancêtres du Rock’n’roll.
C’est la grande remise en question du Rock’n’roll en cette fin des années 70. On balance tout à la poubelle, on bannit les virtuoses et l’on érige l’amateurisme au pinacle. On coupe les racines Blues, on fait table rase du passé et on crache l’énergie de la jeunesse pour trouver l’ADN Rock tant convoitée. C’est effectivement le meilleur moyen de toucher au plus près la « Substantifique moelle » du genre mais les racines Blues ne se laissent pas couper si facilement. La grande vague Punk qui déferlera violemment sur le petit monde de la musique et emportera tout sur son passage laissera pourtant hors de l’eau quelques écueils bien tranchants qui ne manqueront pas de lacérer la coque du grand navire Rock.
Et parmi ces écueils bien aiguisés, ces récifs à fleur d’eau, les Australiens – d’origine Écossaise – d’ AC/DC.
C’est donc à la toute fin de l’an de grâce 1973, que le nouveau groupe des frères Young donne son premier concert dans un club miteux de Sydney. Les débuts sont tâtonnants à cause d’une section rythmique bancale qui va beaucoup changer durant cette première année.
Dave Evans, le chanteur d’alors, ne parviendra également pas à s’accorder avec les électriques Brothers Young qui trouvaient Evans bien trop Glam à leur goût et bien loin des stridences Bluesy de la Gibson SG d’Angus.
C’est une connaissance de George Young – l’aîné des frangins qui tenait alors la basse, puis passera à la production – un certain Ronald Belford Scott dit Bon qui va venir tenter sa chance derrière le micro du groupe.
Et là, c’est la révélation ! L’évidence !
La voix de Bon Scott est bénie au bourbon par les Dieux du Rock’n’roll et colle aux riffs couillus d’Angus et Malcom Young aussi parfaitement que ta main moite sur le fessier rebondi d’Alexis Texas.
C’est l’alchimie parfaite entre un guitariste et son chanteur, l’amalgame magique qui va fonder en ce milieu des seventies un Rock’n’roll intemporel, un Hard Rock pur comme le diamant.
De 1975 à 1976, les Australiens vont lâcher deux premiers albums solides et prometteurs (High Voltage et Dirty Deeds Done Dirt Cheap), tout en continuant à écumer les rades crasseux de l’Océanie profonde.
C’est avec l’expérience de vieux roublards abonnés aux sons des chopes qui s’entrechoquent et habitués à continuer de jouer entre deux bastons de fins de soirée dans quelques pubs miteux du fin fond de l’Australie ou de la Nouvelle-Zélande que nos cinq amis débarquent un beau jour de janvier 1977 aux Albert Studios de Sydney.
C’est par un larsen, une stridence « Marshallienne », que s’ouvre l’album dès l’intro dantesque de Go Down. Ce larsen comme une signalétique « Danger » placée en tout début d’album pour décourager les oreilles sensibles, comme l’avertissement sonore d’un Rock débarrassé de ses chaînes et laissé en liberté, un Rock indomptable prêt à te croquer les miches et les enterrer au fond du jardin.
Car si les deux premiers albums du groupe laissaient présager le meilleur en dessinant ce qui deviendra la structure – basique ? – du groupe, avec un Blues-Rock couillu, une simplicité rafraîchissante: une gratte, un jack, un ampli, en direct, sans aucun intermédiaire qui viendrait toucher à la sacro-sainte saturation Marshall. Une section rythmique carrée comme le menton d’Amélie Mauresmo, une voix aigüe lézardée de partout comme une putain de ruine Romaine, chaude et ample comme un twerk d’Alexis Texas et des paroles au double sens douteux qui viennent gentiment te chatouiller sous la ceinture.
AC/DC était en germe sur ces deux premiers albums – souvent remodelés au gré des continents et des puritanismes de chacun (Crabsody in Blue sera d’ailleurs remplacée par Problem Child sur cet album) – mais quelques ralentissements de rythme et autres choix moins judicieux venaient troubler la cohérence Hard-Boiled des albums. Ce sera donc Let There Be Rock qui finira d’achever la monstrueuse mutation d' »Assedèce » et fera rentrer le groupe dans le dictionnaire Rock en bonne place à la lettre « A ».
Pas de fausse note sur cet album – allez, juste une petite perte de mojo sur Dog Eat Dog si l’on veut chipoter mais qui restera sans conséquence -, pas de morceau bouche-trou, pas de titres jetés par dessus l’épaule qui risquerait de briser la cohésion du skeud (comme un Little Lover sur High Voltage ou un Ain’t No Fun (Waiting ‘Round to Be a Millionaire) sur Dirty Deeds… par exemple). C’est un bloc. Un pan entier de la montagne Hard-Rock qui te tomberait sur les pompes.
Dès les premiers accords de Go Down, le son – Et quel son ! – te happe entièrement et te file la première beigne d’une longue série. Le riff est d’un classicisme implacable, et tandis que Bon vient gueuler son hymne moite à la fellation qui ferait rougir une star du porno, incitant sa belle à se foutre à genoux pour discuter en direct avec Charles le chauve, c’est Angus qui vient lâcher le premier solo de l’album, un solo plein de stridences et d’harmoniques « sifflantes » maîtrisées à la perfection par le plus jeune des frères Young.
C’est ensuite la parole divine que vient annoncer Père Bon de sa voix rouillée au Bourbon. Let There Be Rock. Que le Rock soit ! Et le putain de Rock fut ! Bon Scott gueule son sermon sur les origines de la création – du Rock’n’roll ! – dans une messe électrique où l’enfant de choeur Angus Young distribue à l’assemblée effarée une eucharistie brûlante et pas franchement catholique, un solo survolté où le fantôme de Chuck Berry vient tirer les oreilles des auditeurs et prendre possession du corps (Le célèbre « Duck Walk » de Berry repris par Young) et des doigts du jeune servant de messe. C’est un évangile apocryphe que Bon vient annoncer et parvient à faire entrer à la force du poignet dans le corpus biblique du Rock’n’roll. La continuation d’une évangélisation musicale, de la diffusion permanente de la bonne parole Rock, tout en s’inscrivant comme acteur majeur de cet évangile en perpétuelle construction.
https://www.youtube.com/watch?v=o8lnCna5dOs&list=PLAD6312B6E7E284CD
Avec Bad Boy Boogie, Bon retrace son parcours de petite frappe dans les bas-fonds de Fremantle au son d’un Boogie infernal qui servira d’exutoire exhibitionniste à un Angus qui profitera de la portée sexuelle de ce riff entêtant pour se désaper et montrer ce corps rachitique d’éternel adolescent lors des Grand-messes électriques du groupe.
Problem Child (Déjà présent sur Dirty Deeds…) qui vient remplacer le très osé Crabsody in Blue (qui narre une épidémie de morpions qui avaient fait leur nid dans le slibard des membres du groupe lorsqu’ils vivaient ensemble dans une piaule de Sydney) ne dépareille pas dans ce vacarme Rock qui ne débande pas d’un centimètre.
Dans ce chaudron bouillonnant, dégueulant de Hard-Rock de tous les côtés, – Dont le solide Hell Ain’t a Bad Place to Be trouve parfaitement sa place – dans cette vibration électrique incessante, dans ce priapisme Rock’n’roll qui ne semble plus jamais redescendre, les mômes viennent ralentir la cadence et nous offrir Overdose. Une sorte de Blues poisseux qui colle aux semelles et entraîne AC/DC vers une ambiance plus glauque, plus sombre, qui leur sied à merveille et qu’ils réitéreront quelques fois (Le Night Prowler de Highway to Hell sera dans cet esprit là).
Les Australiens viendront clore ce monument du Hard-Rock avec le somptueux Whole Lotta Rosie (dont la légende raconte que l’ampli d’Angus aurait pris feu durant l’enregistrement du solo du morceau et qu’emporté par son solo, celui-ci ne s’en apercevra pas et continuera à jouer, George Young ne voulant pas couper son cadet en pleine transe « guitaristique »). Ode perverse de Bon à l’une de ses nombreuses conquêtes dont l’embonpoint et l’insatiabilité sexuelle valait bien ce Blues furieux qui prendra sur scène, et à l’image de sa ronde égérie, des proportions Giannamichaelsiennes et une ampleur Rock qui emmènera les live du groupe sur l’Olympe tant désirée du Rock’n’roll.
Au beau milieu de cette vague Punk, de ces gamins mal élevés qui voulait couper leurs racines, mettre le feu aux ancêtres et se réinventer sur les cendres d’un genre moribond; AC/DC va souffler sur les braises du Rock’n’roll et faire revivre ce feu que l’on croyait éteint.
C’est le réveil de la bête qui sonne avec la sortie de Let There Be Rock. AC/DC trouve la formule magique qu’ils avaient frôlé lors des deux premiers albums, et en bons alchimistes, transforment le plomb en or, le groupe de bar en bête de stade et leur Blues-Rock tâtonnant en Hard-Rock sauvage et dur comme l’acier.
Et le Rock fut !
Renaud ZBN
AC/DC – Let There Be Rock est sorti le 23 juin 1977 sur le label Atlantic.