Un an seulement après la parution du premier tome de sa trilogie libanaise, Frédéric Paulin conclut cette œuvre qui fera date avec Que s’obscurcissent le soleil et la lumière, un roman puissant, passionnant et bouleversant. Tout simplement magistral !

Le 22 août 2024 paraissait Nul ennemi comme un frère, premier volet d’une nouvelle trilogie signée Frédéric Paulin. Depuis sa trilogie Benlazar, on le savait capable de manier avec habileté et intelligence faits réels et fiction, un talent confirmé aussi sur un format plus court avec La Nuit tombée sur nos âmes, roman indépendant qui revenait sur les terribles événements de juillet 2001 autour du sommet du G8 à Gênes. Malgré cela, Nul ennemi comme un frère nous avait impressionnés et laissés sans voix. Paulin y racontait les années 1975-1983, la guerre civile au Liban, l’implication du gouvernement et des services secrets français… Roman du chaos, ce premier volume était sidérant de maîtrise. Complexe, exigeant, mais surtout passionnant, Nul ennemi comme un frère n’était pourtant que le point de départ d’une trilogie de plus de mille pages qui réussit le pari exceptionnel de ne connaître aucune faiblesse. Le deuxième volume paru en janvier 2025, Rares ceux qui échappèrent à la guerre, couvrait les années 1983-1986 : la guerre toujours, les attentats à Paris, les manœuvres des politiques en coulisses…
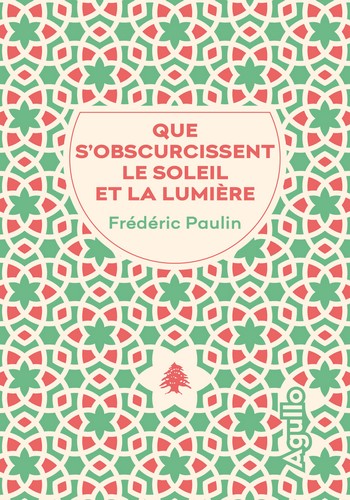 Septembre 2025 : voici donc la conclusion de cette trilogie avec Que s’obscurcissent le soleil et la lumière. Au passage, il faut aussi souligner la beauté des titres des romans de Frédéric Paulin… Ce nouveau roman se déroule entre 1986 et 1990, et commence exactement là où s’était arrêté le précédent, Rares ceux qui échappèrent à la guerre, à Paris alors que vient d’exploser une bombe rue de Rennes. On y retrouve donc les personnages que l’on suit depuis Nul ennemi comme un frère : Caillaux, Sandra, Kellerman, Nada, Dixneuf, Zia, Abdul Rasool al-Amine. Flic, juge, diplomate, politique, député, agent secret, terroriste… Ils sont à nouveau embarqués dans le fracas de l’histoire, dans le chaos d’événements dévastateurs et, autant prévenir le lecteur, rien ni personne ne sera épargné par la folie qui éclate partout autour d’eux.
Septembre 2025 : voici donc la conclusion de cette trilogie avec Que s’obscurcissent le soleil et la lumière. Au passage, il faut aussi souligner la beauté des titres des romans de Frédéric Paulin… Ce nouveau roman se déroule entre 1986 et 1990, et commence exactement là où s’était arrêté le précédent, Rares ceux qui échappèrent à la guerre, à Paris alors que vient d’exploser une bombe rue de Rennes. On y retrouve donc les personnages que l’on suit depuis Nul ennemi comme un frère : Caillaux, Sandra, Kellerman, Nada, Dixneuf, Zia, Abdul Rasool al-Amine. Flic, juge, diplomate, politique, député, agent secret, terroriste… Ils sont à nouveau embarqués dans le fracas de l’histoire, dans le chaos d’événements dévastateurs et, autant prévenir le lecteur, rien ni personne ne sera épargné par la folie qui éclate partout autour d’eux.
Comme dans les précédents volumes, Frédéric Paulin excelle dans l’art d’insérer de la fiction dans la réalité qui sous-tend le récit (le roman est d’ailleurs émaillé de séquences télévisées ou d’interviews, bien connues pour certaines d’entre elles). Mais cette réalité, celle que l’on connaît tous, ne suffit pas au romancier. Son projet romanesque – qu’il travaille depuis la trilogie Benlazar – consiste justement à lever le voile et à nous montrer les coulisses, ce que les historiens savent mais que le grand public ignore sans doute. Autrement dit, il nous est fréquemment arrivé d’interrompre notre lecture pour effectuer quelques recherches afin de compléter et donc de mieux comprendre ce que nous avons découvert en lisant le roman de Frédéric Paulin. L’œuvre de cet auteur est donc riche d’informations qu’il nous transmet grâce à un travail de recherches que l’on devine colossal.
Mais, il nous faut répéter ce que l’on a déjà écrit à propos des deux autres volumes : Paulin ne sacrifie jamais le romanesque. Que s’obscurcissent le soleil et la lumière est donc passionnant de bout en bout et nous emporte littéralement : on tremble pour les personnages, on partage leurs doutes, on pleure pour ou avec eux et l’on n’est pas prêt d’oublier Kellerman, Caillaux, Sandra, Dixneuf et les autres.
En refermant Que s’obscurcissent le soleil et la lumière, on se dit alors que Frédéric Paulin a réussi ce que Ellroy ou DOA sont parvenus à accomplir avant lui, le premier avec Underworld USA, le second avec Citoyens clandestins ou Pukhtu. Écrire une œuvre qui fera date, une œuvre colossale qui nous oblige à nous poser une question : mais que va-t-il pouvoir écrire après cela ?
![]()
Grégory Seyer
