Mauvaises Herbes, le premier roman de Dima Abdallah parait chez Sabine Wespieser. Un roman dur et éprouvant. Violent et vrai. Rempli à ras bord de souffrance. Et qu’on aime pour cela.

Apnée
Il y a ces livres qu’on ne peut pas lâcher parce qu’on se sent bien avec les personnages. L’histoire est captivante et on veut à tout prix aller jusqu’au bout, on ne dormira pas tant qu’on n’aura pas tourné la dernière page, lu le dernier mot. Quitte à s’épuiser. C’est pour ça qu’on les aime. Et ils y a les livres pour lesquels on s’épuisent parce que l’histoire est dure. Mais on ne les lâchera pas non plus. On ira jusqu’au bout aussi, d’une traite ou presque. Par respect pour les personnages, pour leur souffrance qu’on comprend et qu’on aime. Par respect aussi pour l’auteur – qui a peut-être mis un peu de lui ou d’elle dans tout ça. Mauvaises Herbes, de Dima Abdallah, est de ce genre. Je crois. A lire en grandes plongées – un tiers, la moitié du roman. En apnée. Une goulée d’air et c’était reparti. Impossible de faire autrement.
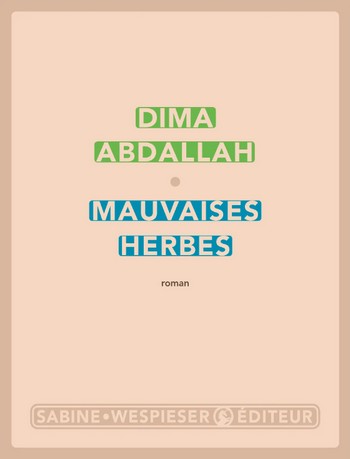 Certains lâcheront. Et ne reprendront pas. Sans aucun doute. Mauvaises Herbes n’est pas un livre facile, plaisant, agréable. Au contraire. C’est un livre dur, éprouvant, sans guère de lumière ou de joie, sans concession, toujours sur le fil du rasoir, un rasoir bien acéré qui pénètre la chair à la moindre pression, qui fait mal. Il n’y a aucun moment – ou presque – pour respirer, aucun moment où la tension diminue qui pourrait laisser passer un peu d’air pour que les plaies cicatrisent. Même les rares moments d’accalmie n’en sont pas. Des apparences de plaisir. Des sortes de joies. Illusoires et on le sait – parce qu’on fait la même chose dans nos vies et qu’on ne se fait pas avoir. La tristesse de ces moments de paix est encore plus insoutenable que la violence des moments de guerre. Difficile dans ces conditions de trouver un moment pour couper, glisser un marque page et aller éplucher des carottes pour le repas, faire les courses ou même se faire un café. Alors on continue… avec elle.
Certains lâcheront. Et ne reprendront pas. Sans aucun doute. Mauvaises Herbes n’est pas un livre facile, plaisant, agréable. Au contraire. C’est un livre dur, éprouvant, sans guère de lumière ou de joie, sans concession, toujours sur le fil du rasoir, un rasoir bien acéré qui pénètre la chair à la moindre pression, qui fait mal. Il n’y a aucun moment – ou presque – pour respirer, aucun moment où la tension diminue qui pourrait laisser passer un peu d’air pour que les plaies cicatrisent. Même les rares moments d’accalmie n’en sont pas. Des apparences de plaisir. Des sortes de joies. Illusoires et on le sait – parce qu’on fait la même chose dans nos vies et qu’on ne se fait pas avoir. La tristesse de ces moments de paix est encore plus insoutenable que la violence des moments de guerre. Difficile dans ces conditions de trouver un moment pour couper, glisser un marque page et aller éplucher des carottes pour le repas, faire les courses ou même se faire un café. Alors on continue… avec elle.
Beyrouth, la guerre civile et la vie
Nous sommes en 1983. A Beyrouth, c’est la guerre civile. Elle a 6 ans, son père vient la chercher à l’école, elle lui tient le doigt et il la guide jusqu’à la voiture pour rentrer chez elle. Elle raconte le retour à l’appartement, qu’ils occupent temporairement en attendant de repartir encore et toujours, la circulation un peu chaotique, les rues et immeubles abîmés par la guerre, les coupures d’électricité, les portraits des martyrs affichés sur le chemin. Elle raconte aussi et surtout l’école. Les relations difficiles – impossibles – avec les autres enfants. L’isolement, sa seule façon d’être au monde. Elle raconte aussi les plantes que son père a achetées – les plantes, cela lui restera tout sa vie. Ils les arrosent ensemble. Il lui apprend à prendre les feuilles entre ses doigts. C’est plus facile que de parler… et pourtant, les mots, il connaît – il est poète, mais les mots pour les autres. La poésie aussi lui restera toute sa vie.
1984. Elle a 7 ans. A Beyrouth rien n’a changé. A l’école non plus. Ni avec son père. Les plantes. La poésie. La violence des sentiments. La peur du noir, aussi. L’angoisse. Toujours. Qui s’intensifie et lui vient par crises. Elle continue de raconter. 1985, 8 ans. Les années passent. La famille déménage à Paris – sauf le père qui lui reste à Beyrouth. L’école, impossible ; les autres, impossible. Sandrine – qu’elle rencontre, qu’elle perd. Elle essaye de continuer, s’enfuit, revient, va voir son père qui vient la voir à Paris. Elle va le voir … Elle raconte ces années. De chapitre en chapitre, entre lesquels viennent les sentiments du père qui lui aussi raconte. La poésie, l’écriture, les plantes, le café et l’eau. Les cigarettes. Sa fille a qui il n’a jamais parlé. Parler… le regret, la culpabilité. Si cela avait été différent… Mais a-t-on besoin de parler ? Cela aurait-il pu être différent? Qu’est-ce que cela aurait changé ? Cela n’aurait engendré que d’autres regrets, une autre culpabilité, une autre angoisse. Mais ils ne le savent pas, ne le comprennent pas – qui le comprend vraiment? Alors ils continuent et nous avec eux.
La violence des sentiments vrais
Certains lâcheront et ne reprendront pas Mauvaises Herbes peut-être parce que la gamine de 6 ans qui parle n’a pas l’air d’avoir 6 ans — ou alors les enfants d’aujourd’hui parlent vraiment comme des adultes. Pas plus qu’elle a l’air d’en avoir 7 ou 8 ou même 12 ou 14. Elle parle comme une adulte. Elle raconte avec des mots d’adultes ses sentiments d’enfant. Cela m’a gêné. J’ai résisté, et j’ai fini par lâcher prise et me laisser emporter. Le récit m’avait semblé artificiel, mais les sentiments ne l’étaient pas. Quoi qu’il en soit, cela ne pouvait être dit qu’avec des mots d’adultes. Impossible de raconter des sentiments aussi violents et profonds avec des mots d’enfants. Parce qu’un enfant ne dit pas, qu’il vit et n’a pas les mots pour le dire. Alors, peu importe que ce soit une adulte et pas une enfant qui raconte. La peur, l’angoisse, la culpabilité, les regrets et les remords que les personnages — la gamine, l’adolescente, l’adulte, du père – éprouvent. L’enfermement. L’amour aussi, entre un père et une fille et une fille et son père. L’amour pour Sandrine. Les plantes et l’écriture. Leur envie – vaine et illusoire – que les choses soient différentes. Ces sentiments vrais, martelés sans arrêt, portés, charriés plutôt par les phrases de Dima Abdallah. Des phrases puissantes, majestueuses, lourdes sans maniérisme aucun. Poétique aussi. Un premier roman vrai.
![]()
Alain Marciano
