Pas forcément les « meilleurs » disques des années 70, mais ceux qui nous ont accompagnés, que nous avons aimés : aujourd’hui, Black and White, un grand album de l’un des groupes les plus singuliers du punk rock anglais, The Stranglers.

L’un des mes groupes préférés de tous les temps est les Stranglers. Parce que leur image de dangereux pervers était irrémédiablement décalée par rapport aux canons du rock, même punk. Parce que leur musique n’hésitait jamais à plonger dans l’excès et la grandiloquence, voire l’avant-gardisme radical, sans jamais perdre sa brutalité inouïe. Parce que les Stranglers, quelque part, faisaient peur « pour de vrai », comme lorsque Jean-Jacques Burnel descendait dans la foule lors d’un concert pour casser lui-même la tête à quelqu’un qui ne lui revenait pas ! Et Black and White, au milieu d’une discographie exceptionnelle, tout au moins jusqu’en , restera mon album chouchou des « étrangleurs de Guildford » : célébration nauséeuse et glaciale, mais parfois épique, de vies crucifiées et de morts atroces, c’est un disque aussi inclassable qu’intemporel.
 Commençons par un élément essentiel, que nous négligeons trop souvent dans les chroniques de nos « albums essentiels » : la pochette ! En 1978, la superbe photo « black and white » de la pochette du troisième album des Stranglers avait fait beaucoup parler d’elle. Comme tout ce qui touchait la vie sordide et agitée de ceux que la presse anglaise adorait haïr, en fait. La posture singulière de Cornwell et Burnel, l’air vaguement accablé de Jet Black et Greenfield ? Aucune mise en scène, juste un lendemain de cuite particulièrement sévère en Islande. Mais, peu importe, après les rats et la couronne mortuaire des pochettes précédentes, un peu « cheap », les Stranglers avaient enfin une image digne de leur musique !
Commençons par un élément essentiel, que nous négligeons trop souvent dans les chroniques de nos « albums essentiels » : la pochette ! En 1978, la superbe photo « black and white » de la pochette du troisième album des Stranglers avait fait beaucoup parler d’elle. Comme tout ce qui touchait la vie sordide et agitée de ceux que la presse anglaise adorait haïr, en fait. La posture singulière de Cornwell et Burnel, l’air vaguement accablé de Jet Black et Greenfield ? Aucune mise en scène, juste un lendemain de cuite particulièrement sévère en Islande. Mais, peu importe, après les rats et la couronne mortuaire des pochettes précédentes, un peu « cheap », les Stranglers avaient enfin une image digne de leur musique !
Black and White est un album qui divisa la critique à sa sortie, et divise sans doute toujours autant les fans aujourd’hui. On y entend les quatre de Guildford, sans doute satisfaits d’avoir gagné leur crédibilité « punk » avec leur second album, commencer à explorer d’autres formes musicales, frôlant parfois l’avant-garde. La guitare de Cornwell est en retrait, à l’exception du titre d’ouverture, Tank, assez faiblard par rapport au reste de l’album, et peu caractéristique de ce que l’on entendra ensuite. Et ce sont les claviers du génial Dave Greenfield (l’un des plus GRANDS claviéristes du Rock, avec Ray Manzarek, auquel il a été souvent comparé…) qui constituent l’essence d’un album déjà plus franchement « new wave » qu’autre chose. Ceux qui n’aiment pas Black and White déplorent l’absence de grandes mélodies inoubliables comme The Stranglers en ont produit tellement tout au long de leur carrière (y compris ces dernières années !). Il n’y a sans doute que les formidables Nice’n’Sleazy, Toiler on the Sea (un titre qui frôle le prog rock !) et Death and Night and Blood, qui seront considérés, à l’unanimité, comme des hauts faits au milieu de la longue discographie du groupe.
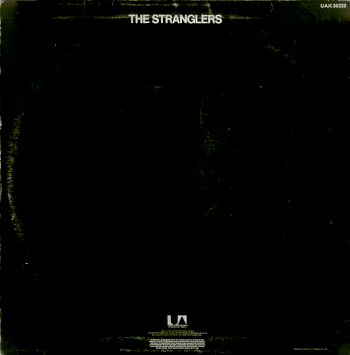 Mais Black and White offre bien d’autres plaisirs : une superbe inventivité sonore et structurelle (la première valse du groupe sur Outside Tokyo, le rythme en 7/4 de Curfew…), des textes ambitieux nourris de références artistiques et littéraires (Mishima !) qui passaient à l’époque bien au-dessus de la tête de la majorité des punks… Et toujours cette attitude incroyable du groupe, qui a su cette fois abandonner la provocation sexuelle facile des deux premiers albums pour devenir véritablement… dérangeant.
Mais Black and White offre bien d’autres plaisirs : une superbe inventivité sonore et structurelle (la première valse du groupe sur Outside Tokyo, le rythme en 7/4 de Curfew…), des textes ambitieux nourris de références artistiques et littéraires (Mishima !) qui passaient à l’époque bien au-dessus de la tête de la majorité des punks… Et toujours cette attitude incroyable du groupe, qui a su cette fois abandonner la provocation sexuelle facile des deux premiers albums pour devenir véritablement… dérangeant.
Il faut aussi replacer cet album dans son contexte au sein de l’histoire des Stranglers : avec le succès commercial qui s’annonçait, le groupe commença à littéralement sombrer dans un tourbillon d’excès (alcool et drogues dures), de scandales, de bastons qui ne le fit guère apprécier de la presse anglaise, toute-puissante à l’époque. Les récits des méfaits de Burnel & Cie sur le continent, et en particulier en Scandinavie, pourraient remplir un roman tout entier : même si les musiciens se sont ensuite (plus ou moins) excusés pour leur comportement, une aura de danger les accompagna longtemps.
PS : Black and White ne saurait s’écouter sans y intégrer la formidable reprise de Walk on By (une composition de Burt Bacharach chantée à l’origine par Dionne Warwick), qui était inclus à l’époque de la première édition sous la forme d’un 45 Tours de vinyle blanc glissé dans la pochette.
![]()
Eric Debarnot

En 1978, j’avais 10 ans, mon frère ainé de quatre ans avait acheté le disque, et la pochette me faisait peur, en particulier la grosses tête méchante de Jet Black.
Ce disque contient en bonus CD la reprise géniale de Walk on By, avec une longue envolée musicale au milieu, comme au bon vieux temps des Doors, et c’est très très bien fait !
Hugh CORNWELL est un très grand chanteur.
Nice’n’Sleazy est une très grande chanson.
Un album immortel.
J’adorais les Stranglers, je les ai vus 3 fois en concert, la 1ere fois en 1979 au Palais d’Hiver à Lyon pour la tournée » the Raven », concert génial surtout que j’assistais alors à presque 1 concert par semaine (Blondie, Thé Crampe, Bowie,…), et celui là reste mon préféré des 3. J’ai tous les 33 tours avec les fameuses pochettes, et plus tard j’ai tout racheté en CD. Du pur bonheur, encore aujourd’hui à 65 ans. Eh oui, malheureusement on vieillit tous helas.
C’est clair que ce groupe période Cornwell est phénoménal quand il balance ses meilleures chansons. J’avais lu une fois que Tony Visconti le tenait pour l’une des plus belles voix parmi ses nombreuses collaborations. Et les claviers de Dave Greenfield sont remarquables. Lorsque j’écoute une compilation de mes titres favoris, c’est quand même diablement bien foutu avec ce rock bien tendu. Sans compter la « légende noire » des lascars qui ont bien tapé sous la ligne de flottaison au point de frôler le naufrage.